Le Monde diplomatique – Marie-Joëlle Rupp – Mai 2008
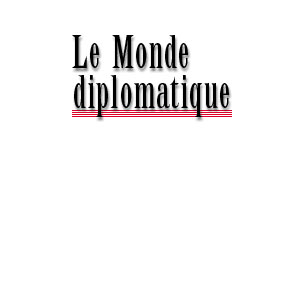
Littérature du Monde
Le linceul rwandais
LA FEMME AUX PIEDS NUS
Les récits de Scholastique Mukasonga se situent dans ce courant littéraire qualifié d’écriture de l’après-Rwanda. Tutsie installée en Normandie, seule survivante des trente-sept membres de sa famille directe, elle a témoigné du quotidien des persécutions au Rwanda jusqu’en 1994 dans un premier ouvrage paru en 2006 chez Gallimard, Inyenzi ou les Cafards. Si ce récit autobiographique visait à rendre compte des différentes étapes de la purification ethnique ayant abouti au génocide, son second ouvrage, La Femme aux pieds nus, met l’accent sur le rôle des femmes tutsies dans la tentative de préservation du lien social.
Stefania, la mère de l’auteure, assassinée pendant le génocide, est le personnage central du récit. Autour d’elle se réorganisait la vie des déplacés au village de Nyamata dans le Bugesera, une région inhospitalière à la périphérie du Rwanda. Une vie traquée où les rires de la fratrie s’abîment dans le fracas des tôles de la case renversée par la soldatesque. Ici, les dits de la terreur côtoient ceux d’une enfance apaisée par la présence de celle qui s’acharne à maintenir coûte que coûte la cohésion du groupe. D’autres portraits de femmes, touchants, cocasses, émaillent la composition : Suzanne, la garante de la virginité des filles à marier ; Claudia, la fille sans mari ; Kilimadame, qui introduit le pain à Nyamata. Elles constituent le parlement des femmes, la trame du pagne communautaire.
Mukasonga reconstruit son Afrique, son Rwanda. Celui de la vie quotidienne au village et cette obsession permanente : sauver les enfants. Elle se souvient de sa mère guettant les bruits, les signes, repérant les cachettes, creusant sous son lit un tunnel dérisoire pour protéger une hypothétique fuite. Pourtant, au fil du récit, la vie reprend son cours. Stefania construit l’inzu, la demeure originelle où puiser force et courage. Gardienne du feu, elle est aussi celle de la tradition. C’est elle qui cultive le sorgho, le « roi des champs », et qui célèbre la fête des moissons selon les rites ancestraux. Tandis qu’elle procède aux incantations, le père dit le bénédicité, et les plantes de bon augure, celles des médecines traditionnelles, voisinent avec les palmes du dimanche des Rameaux bénites par les « bons pères ». Le pays des Blancs, on y accède par le baptême ; mais les mères de famille font de la résistance, et les histoires de la Bible s’arrêtent là où commencent les contes, le point d’ancrage. Il convient de se concilier Marie au même titre que Ryangombe, le maître des esprits : « Il faut sarcler tous les sorghos (…), on ne sait jamais celui qui donnera le premier. » La terreur de la persécution n’éteint pas le désir, et les flaques d’eau servent de miroir aux belles. Stefania est une marieuse réputée, juge des canons de la beauté mesurés à l’aune de la vache royale dont le beurre sert de remède universel.
Dans ce récit composite, l’auteure fait à la fois œuvre d’ethnologue sourcilleuse et de conteuse, investissant le champ de l’imaginaire avec cette empreinte poétique puisée dans la grammaire de l’oralité. C’est cette double tonalité qui donne son originalité au récit. Avec la méticulosité opiniâtre du survivant qui n’omet ni le moindre geste ni le moindre détail, et moins encore le rituel, elle recouvre le corps exposé de sa mère d’un linceul de mots, s’acquittant ainsi de sa dette car « personne, lui disait-elle, ne doit voir le cadavre d’une mère ».
Par Marie-Joëlle Rupp.


