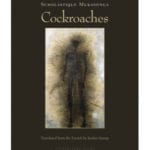Diacritik : Papillons épinglés (Cœur tambour)

A lire dans le magazine culturel Diacritik une critique de Elara Bertho sur mon dernier roman ‘Cœur Tambour’ paru aux éditions Gallimard
Lire l’article complet sur le site Diacritik.
Au commencement était une disparition : Kitami, la chanteuse internationale, Kitami, l’étoile rwandaise, Kitami est morte. Son chant ne résonnera plus sur scène, ses disques ne seront plus en tête des ventes du box office.
Un an plus tard, le narrateur mène l’enquête. Assassinat, disparition, suicide ? « L’énigme, digne d’un roman policier à l’ancienne, semble surtout attirer des détectives autoproclamés et des romanciers en mal d’inspiration » (p. 60). Très inspirée pourtant, Scholastique Mukasonga célèbre ici les femmes, et les esprits qui reviennent hanter les vivants, les tambours, les exilés et les marginaux, les reggaemen et les rastafari, les sorcières et les chanteuses de gospel. Entre le roman noir, la fresque historique, et l’enquête policière, ce très beau roman polyphonique dresse une généalogie fantasmée d’une succession de femmes prophétesses, suscitant la terreur autant que la fascination, dont Kitami est l’héritière.
Reprenons. Trois joueurs de tambours, tout à la fois interlopes et clochards célestes – Livingstone, Baptiste Magloire et James Rwatangabo – effectuent une tournée à travers l’Afrique, avec pour destination l’Éthiopie mythique des Rastafari, à la recherche des sources des rythmes jamaïcains et guadeloupéens. En chemin, ils croisent une jeune femme à la voix envoûtante, la rwandaise Prisca, qui se dit possédée par la reine Kitami dont elle prend le nom, en rupture de ban et marginalisée, accusée d’être sorcière, devineresse, et surtout Tutsi. Ils organisent son enlèvement, ainsi que celui d’un tambour sacré nommé Ruguina, « le Rouge », et parcourent ensemble les studios et les salles de spectacles. Allant de succès en succès, le groupe devient une référence mondiale, et Kitami, une diva à l’aura mystérieuse. Dans la lignée des grandes fresques musicales, telles que le désormais classique Le lys et le flamboyant d’Henri Lopès ou le magnifique roman Les grands de Sylvain Prudhomme, ce récit est un éloge du chant, et des hybridations de langues : car Kitami chante autant en kinyarwanda, qu’en yoruba, en swahili, en amharique, ou encore en créole…
L’auteur de Ce que murmurent le collines et Notre-dame-du-Nil, lauréate du prix Renaudot en 2012, livre ici un splendide portrait de femme mystérieuse, où le chant est une possession, un carmen, au sens le plus littéral du terme, un « charme ». Ainsi de la première entrée en scène de la toute jeune Prisca, à l’école des missionnaires où elle apprenait le gospel : « Lorsque je m’avançai au bord de l’estrade, comme poussée par le grondement des tambours, je fus saisie par un chant qui ne m’appartenait pas et qui n’avait en tous cas rien à voir avec les quelques mots anglais extraits du gospel, chant qui n’aurait peut-être jamais cessé si le père Martin ne s’était précipité sur scène et ne m’avait traînée à peu près inconsciente derrière le demi-cercle des tambours » (p. 87). La chanteuse, comme dans le mythe de l’écrivain inspiré par la Muse, est toute entière possédée par le rythme des tambours – de leurs cœurs battants – et inspire à son tour au public une fascination qui provoque aussi l’effroi. Puisant dans les influences du milieu rastafari, qui vénère Hailé Sélassié, autant que chez Jimmy Cliff ou encore du côté des esprits zar éthiopiens – que Michel Leiris a décrits lorsqu’il était auprès d’une autre figure de femme ensorcelante : la jeune Emawayish, dont la grâce et la virtuosité à composer des vers autant qu’à dialoguer avec les esprits le fascinait –, le chant de Prisca-Kitami est un chant de résistance des opprimés, des femmes Tutsi mariées de force aux Hutu, des exilés du monde entier, des esclaves marrons en fuite, des révoltés et des marginaux des grandes agglomérations aux banlieues tentaculaires… Qu’est-ce qu’en effet que ce chant, à la fois divin et personnel, travaillé et inspiré, exaltant et captivant, si ce n’est l’allégorie de la création littéraire ?
À l’instar du meurtre initial du conteur Solibo, dans Solibo Magnifique de Chamoiseau, le poète, l’artiste, le chanteur, est mort au début du récit, et le livre se construit sur les circulations de rumeurs, de contes, d’affabulations récoltés à son sujet. Tout en proclamant le caractère irremplaçable de l’oral, c’est l’écrit qui prend le relais de ce deuil de l’oralité toujours-déjà perdue. Le chant est mort, vive le chant. Dès l’initiale de l’ouvrage, Kitami le proclame : « L’écrit, disait-elle, tuera tous ces mots qui sont venus en moi sans que je les contraigne, ils ont vécu dans ma bouche d’une vie nouvelle, tout éphémère, à laquelle ils n’étaient pas destinés, si on les imprime sur une page, ils ne seront plus que ces papillons épinglés dans la boîte de l’entomologiste, ils finiront par tomber en poussière » (p. 14). Et pourtant, c’est bien le narrateur qui recompose cette oralité qui n’est plus, par l’accumulation de détails et de récits qui tenteront d’expliquer les causes de la mort de Kitami. Comme chez Chamoiseau, l’écriture se fonde sur une lamentation discrètement mélancolique et nostalgique de la mort du chant, tout en élevant, par la même occasion, un tombeau flamboyant et virtuose, par l’écrit, à l’oralité disparue.
À travers trois récits successifs, les emboîtements de voix et de possessions se multiplient : au fil des narrations, les identités finissent pas se brouiller, et l’on ne sait plus vraiment qui possède qui (« Nyabingui, Nyabingui, de toi ou de moi, quelle est la possédée ? », ose d’ailleurs dire Prisca, p. 148), mais peu importe. Se succèdent tour à tour de magnifiques portraits de femmes : la diva Kitami qui reprend le nom d’une reine africaine, l’esprit de Nyabingui, cette princesse qui se réincarne régulièrement en prenant possession de jeunes filles, notamment de Muhumuza, qui aurait résisté aux Anglais pendant la colonisation, avant d’être capturée et de disparaître mystérieusement… Et toutes coexistent dans le chant qu’élabore en se construisant la jeune Prisca, dans un Rwanda en amont du génocide. De récits de femmes en récits de femmes, les facettes successives de Kitami se composent petit à petit jusqu’à former un vaste cortège fantasmé et fantastique d’héroïnes et d’amazones, toutes révoltées et possédées, donc toutes résolument artistes, finalement.
À l’école des Blancs, elle est brillante élève, bibliothécaire et archiviste, tout en étant également la descendante spirituelle d’une sorcière : Prisca-Kitami réunit décidément les contraires, et illustre dans son chant la symbiose de ces deux univers antagoniques. « Il y aura deux esprits en toi, celui de Nyabingui et celui des Blancs » (p. 100), et ce syncrétisme constitue la richesse de l’écriture de Scholastique Mukasonga. Le roman se dévore d’une traite, au rythme des tambours : de la Caraïbe à New York, de Plymouth à l’Éthiopie, la scène du livre est le monde. Ces fragments de voyages, ces rumeurs, ces coupures de presse, ces carnets de missionnaires et pièces d’archives, ces récits et souvenirs – visant tous à élucider la mort de la chanteuse – constituent autant de « papillons épinglés » à la beauté trouble des mondes disparus : l’oralité, le chant, Kitami.
Scholastique Mukasonga, Cœur tambour, Gallimard, 2015, 176 p., 16 € 50 — Lire un extrait
Partager :