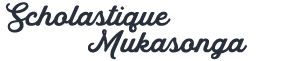Le Courrier – Marc-Olivier Parlatano – 03 Mai 2008
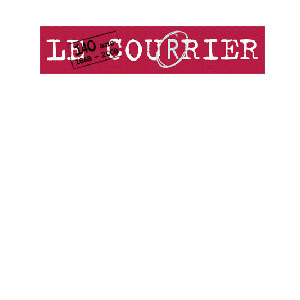
Paru le Samedi 03 Mai 2008
Par MARC-OLIVIER PARLATANO
RWANDA Scholastique Mukasonga raconte sa jeunesse parmi des Tutsis déportés.
«Quand vous me verrez morte, il faudra recouvrir mon corps. Il ne faut pas laisser voir le corps d’une mère. C’est vous, mes filles, qui devez le recouvrir.» C’est avec ce voeu – qui ne pourra être exaucé – que s’ouvre La Femme aux pieds nus, le deuxième livre de l’auteure rwandaise Scholastique Mukasonga. Elle a déjà publié un premier opus, Inyenzi ou les Cafards (2006), un tableau de son enfance. Dans son dernier ouvrage, Scholastique Mukasonga revient sur ses années de formation au Rwanda, mais pas seulement. Il y a autre chose. La dépouille de la mère, donc, n’a pas pu être recouverte comme prévu. Ses restes ont disparu, explique l’auteure, au moment du génocide de 1994 qui a ensanglanté cette petite république d’Afrique centrale. Pour donner une idée de l’ampleur des tueries à l’époque, la région du Nyamata, sur laquelle le livre est centré, comptait 60 000 Tutsis en janvier 1994, contre seulement 5348 rescapés en juillet.
Livre du manque
Alors, La Femme aux pieds nus, roman sur l’ethnocide? Voire! Il ne s’agit pas d’une oeuvre romanesque, d’une part; par ailleurs, les références à 1994 se font rares, discrètes, comme pour rappeler qu’il n’est pas besoin de surligner l’événement, déjà énorme dans son horreur – 800 000 tués en trois mois, soit 8000 par jour (contre 6000 lors du plein régime de la machine de mort d’Auschwitz). Scholastique Mukasonga, plutôt que d’axer la narration sur les assassinats en masse de Tutsis – sa communauté – raconte la vie. Le train-train quotidien de milliers de Tutsis en exil dans leur propre pays sur le territoire du Nyamata, à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale rwandaise Kigali. Car le flot de sang de 1994 n’a pas jailli ex nihilo: après des pogroms perpétrés à la Toussaint 1959, nombre de Tutsis ont été déportés à l’intérieur du pays, devenant des réfugiés dans leur propre Etat. Et ces relégués, parmi lesquels l’auteure a grandi, ont subi des exactions et des meurtres en nombre en 1963, en 1967, en 1973 ainsi qu’en 1992…
L’oppression et la menace marquent le livre de leur spectre, au fil de «chapitres» qui se définissent chacun par un thème: histoires de femmes, pain, sorgho, médecine… Le récit d’un viol, un commentaire sur une coutume que l’on ne peut plus observer (comme raccompagner une visiteuse jusque dans sa maison, parce que les routes sont devenues périlleuses le soir à cause des raids des soldats), donnent le ton, montrent que la description de tel ou tel usage n’est plus «normale» mais infléchie par la peur et la tyrannie.
Ainsi dans son ensemble, La Femme aux pieds nus, voulu comme un hommage de la fille à sa mère Stefania, voire «le linceul dont (elle n’a) pu (la) parer», un tombeau de papier et de mots, relate la vie et les us des Tutsis, l’arrivée du monde moderne, les travaux de la campagne, etc. Mais quelque chose s’est cassé: le cadre social et physique d’antan a disparu avec la relégation; même les vaches, richesse matérielle et symbolique des Tutsis, sujet de fierté et d’admiration, ne sont plus là. Les plantes qui guérissaient, qu’on savait trouver «là-haut», sur la terre ancestrale tel un éden perdu, sont rares, sinon introuvables. Rien ne sonne bucolique; ce livre envoie le message d’un manque. D’un arrachement. D’autant plus que son auteure orpheline compte parmi les survivantes d’un génocide au cours duquel son père, sa mère, et au total trente-sept membres de sa parenté proche, ont péri.
Note : Scholastique Mukasonga, « La Femme aux pieds nus », Ed. Gallimard, coll. Continents noirs, 2008, 144 pp.
En octobre 1994, Scholastique Mukasonga a fondé l’association Orphelins du Rwanda, qui vient en aide aux orphelins du génocide de 1994, www.orphelinsdurwanda.org. L’auteure vit et travaille en France.
Salon du livre.
Samedi 3 mai à 12h, Scholastique Mukasonga participe au débat «Histoire trouée, futur troué: pas de vérité, pas de futur…», sur le stand du Salon africain. Avec l’écrivain Boubacar Boris Diop et Catherine Coquio, présidente de l’Association internationale de recherche sur les crimes et génocides.