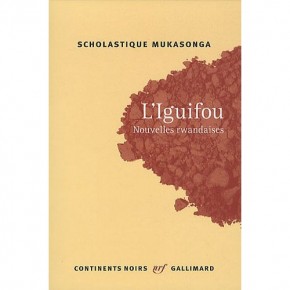Le Litteraire.com – Isabelle Roche – 26 mai 2011
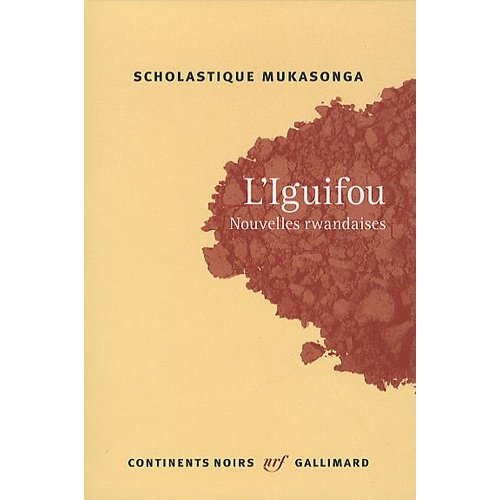
Le 20e prix Renaissance de la nouvelle a été remis le samedi 21 mai 2011 à Scholastique Mukasonga pour son premier recueil – et première œuvre de fiction après deux récits autobiographiques.
Quand Scholastique Mukasonga vient au monde, le Rwanda est déjà déchiré par des conflits intérieurs. Elle est tutsi : elle sera déportée avec toute sa famille à Niyamata, une région rwandaise peu accueillante, alors qu’elle est âgée de 3 ans. La vie est difficile mais, malgré tout, ses parents vont l’encourager à poursuivre sa scolarité. Elle pourra ainsi accéder à l’enseignement secondaire, puis supérieur, et entrer à l’école d’assistante sociale. Avoir de la sorte accès au savoir lui a donné très tôt le sentiment qu’une mission lui était confiée. En 1994, elle s’est retrouvée survivante parce que hors de son pays lorsque fut perpétré le génocide et sa famille décimée. Il y eut dès lors en elle une indicible souffrance à surmonter. Lui apparaissait, aussi, la nature de cette mission dont elle s’était sentie investie dès son enfance : si elle avait survécu, c’est parce qu’elle était destinée à témoigner, de la tragédie et de ce qu’avaient traversé les siens avant le génocide, mais également de la culture qui avait disparu avec les hommes massacrés. Comment allait-elle s’y prendre ? Le premier geste qui lui est venu a été d’écrire – sans intention de publier, ni de vraiment mettre en forme : il s’agissait d’abord de fixer ce qui n’avait d’existence que mentale.
De cette nécessité de témoigner sont nés ses deux premiers livres, des récits autobiographiques – Inyenzi ou les cafards en 2006 puis La Femme aux pieds nus en 2008, tous deux publiés dans la collection « Continents noirs » des éditions Gallimard. Ce travail eut pour conséquence… de lui donner le goût de l’écriture ; elle a donc continué à coucher sur le papier des textes, fondés sur ses souvenirs, ses expériences ou celles de ses proches mais qui cessaient d’être purement autobiographiques. Ce sont eux qui constituent L’Iguifou – Nouvelles rwandaises, le recueil récompensé par le 20e prix Renaissance de la Nouvelle.
Aucun des cinq récits réunis là ne raconte l’exil, les virées des troupes armées ou les tueries génocidaires. Mais tous, et chacun d’une façon différente, en retracent les conséquences sur des êtres dont on découvre les destinées déchirées. Ces récits sont en premier lieu des « tranches de vie », des portraits humains brossés avec sensiblité, pudeur, parfois avec humour. La narratrice de « L’Iguifou » se souvient d’avoir frôlé la mort tant elle était affamée ; celle du dernier texte, après les massacres, part en quête de ses Morts pour pouvoir vivre en bonne intelligence avec sa douleur. Karekesi, lui, se remémore combien son enfance a été heureuse tant que son père a pu prendre soin de son troupeau de vaches et sa mère demeurer la gardienne du lait – ce qu’a réduit à néant l’exil à Nyamata. Et à Nyamata, outre que les vaches ne sont plus là, il y a la peur qui ne quitte jamais tout à fait le cœur des Tutsi, qui fait courir si vite que même les filles fières de leur gros derrière doivent se faire aussi lestes que la gazelle. Mieux vaut savoir détaler à la moindre alerte que d’avoir de la beauté, comme Helena, dont le destin sordide atteste qu’en effet, il n’y a Pas de plus grand malheur que d’être belle au Rwanda quant on [est] tutsi.
« Des vaches, bien sûr, il n’y en avait pas à Niyamata, du moins chez les Tutsi qu’on y avait déplacés, mais mon père passait ses journées à mener ses fantômes de vaches dans les prairies du souvenir et des regrets. »
(« La gloire de la vache », p. 34)
Ces nouvelles sont certes poignantes et émouvantes par ce dont elles parlent, par ce qu’elles évoquent. Mais si elles le sont, c’est parce qu’elles sont écrites de façon à ce que leur charge émotionnelle passe chez le lecteur et que celui-ci se sente immédiatement intéressé par la culture rwandaise, curieux d’elle quand il n’en sait rien. Très descriptifs, les textes dépeignent avec une précision à la fois détaillée et sobre les décors, les personnages, les gestes, les états d’âme… et tous ces passages ont une puissance d’attraction impressionnante.
« [L’Iguifou] avait fait dans mon ventre un trou vertigineux. C’était comme la grande faille de Rwabayanga, à la frontière du Burundi, où, disait-on, on jetait les carcasses d’éléphant et les cadavres de Tutsi. »
(« L’Iguifou », p. 17)
Ce serait une erreur profonde de borner l’attrait de ce recueil à ce qu’il apporte de lumière sur une communauté humaine mal connue, écrasée de tragédies, et de le voir d’abord comme une sorte de document ethnographique qui aurait pour lui d’être bien écrit, de mettre en scène des personnages attachants ou bouleversants. Car chaque texte, en plus d’atteindre à une dimension universelle tout en étant nourri des singularités de la culture tutsi, est d’une authentique littérarité, tant en ce qui regarde la construction que l’écriture. Chacun procède d’un art de la narration maîtrisé, où les niveaux temporels se mêlent sans se confondre tandis que la matière s’organise selon une progression menant sans accroc aux derniers mots, et tous sont de beaux tissages phrastiques – en même temps que l’on sent dans les phrases une sorte d’élan, qui serait la trace subtile d’une spontanéité initiale, on les voit former une prose finement rythmée, où semblent sourdre parfois comme les échos d’un chant lointain, modulé par la présence de ces mots en kinyarwanda que l’éditeur a eu l’intelligence de ne pas transcrire en italiques comme l’exigerait le code typographique. L’on est proche du poème mais le récit s’impose : ces cinq textes sont des nouvelles très réussies. Il est évident qu’en distinguant ce recueil, les jurés ont réellement reconnu ses qualités littéraires et n’ont pas été mus par la seule force de l’émotion.
Après le prix Seligmann qui a couronné en 2008 La Femme aux pieds nus (Gallimard coll. « Continents noirs », 2008) voilà une deuxième récompense qui vient à point nommé encourager un auteur dont la vocation d’écrivain est en train de se développer. L’éclat de ces brillants débuts va, très certainement, s’intensifier.
Suivant un cours qui semble se confirmer depuis plusieurs éditions déjà, les jurés* du prix franco-belge de la nouvelle ont une fois de plus cette année salué un talent émergeant. Il ne saurait y avoir meilleure manière d’œuvrer à la défense et à la promotion de la nouvelle, qui demeure, malgré quelques succès de librairie ponctuels, malgré l’attachement que lui vouent de très grands noms de la littérature, une forme narrative peu éditée et souvent mal vendue : révéler par l’attribution d’une récompense prestigieuse des auteurs qui en sont à leurs débuts – qu’ils en soient à leurs premiers pas littéraires ou que, écrivains reconnus, ils s’essaient pour la première fois à l’écriture de nouvelles – revient, du même coup, à montrer combien écrire des nouvelles est aujourd’hui une part vivante et dynamique de l’activité littéraire, au-delà des cercles peut-être un peu confinés des ateliers et des concours d’écriture que prisent tant les amateurs.
* Le jury 2011 du prix Renaissance de la nouvelle était composé de Alain Absire, Jean Claude Bologne, Georges-Olivier Châteaureynaud, Ghislain Cotton, Marie-Hélène Lafon, Michel Lambert et Claude Pujade-Renaud.